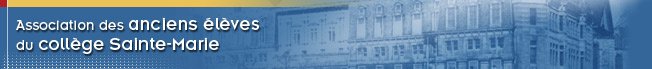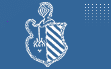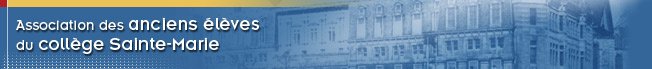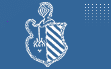Le mot du président
«Une paire de bottes
vaut bien Shakespeare» !
Cette phrase – assassine ! – est d’Alain Finkielkraut
(La défaite de la pensée). Elle m’est
revenue à l’esprit en lisant les propos du Père
Kolvenbach sur le «relativisme» et… l’intolérance
!
Il ne faudrait plus, paraît-il, affirmer des idées
et des opinions : tout serait relatif, lié aux humeurs et
au goût de tout un chacun. La lecture des propos de l’actuel
général des jésuites m’a rassuré
et incité à en faire la recension dans l’article
qui paraît dans le présent bulletin. Cela nous aide
à comprendre pourquoi les jésuites ont été
expulsés d’un peu partout : ils dérangeaient
trop de monde ! Heureusement, ils n’ont pas «lâché»
pour autant ! La meilleure façon de leur exprimer notre reconnaissance
pour tout ce qu’ils nous ont donné serait de faire
ce qu’ils nous ont appris à faire : déranger
quand il faut déranger ! La spiritualité ignatienne
est une «spiritualité du magis» nous
rappelle le Père Kolvenbach : en faire toujours plus ! Excellent
antidote au «qu’ossa donne !» qui court les rues
!
Émile Robichaud
Remonter
Assemblée
générale et Fête annuelle 2005
Cliquez
sur le lien ci-dessous pour accéder au compte rendu et à
l'album de photos de la Fête annuelle 2005.
Fête
annuelle 2005 et album de photos
Remonter
Le
Conseil d'administration 2005-2006

Le conseil d'administration élu le 25 avril 2005
Rangée du bas:
Jacques-Marie Gaulin, C. 48, trésorier, Fernand Potvin, C.
47,
secrétaire et Gilles Dumontier, C. 50
Rangée du centre: Richard L'Heureux, C. 62, vice-président,
Pierre La Buissonnière, C. 68, Serge Moquin, C. 68 et Guy
Dulude, C. 48
Rangée du haut: Émile Robichaud, C. 53, président,
Serge Montplaisir, C. 60.
et Bernard Downs, C. 59
N'apparaissent pas dans la photo
: Bernard Bélair s.j., C. 60, conseiller,
Jean Collard, C. 56, Richard d'Auteuil, C. 57, Maurice Mousseau,
C. 67
et Marie-Danielle Plante, C. 67
Remonter
Propos sur l’éducation
Retour aux sources
Le Père Peter Hans Kolvenbach, s.j., l’actuel général
des jésuites, a accordé à l’historien
et journaliste Jean-Luc Pouthier un «entretien» qui
rappellera à tous les Anciens des jésuites les assises
mêmes de la formation qu’ils ont reçue.1
Le Père Kolvenbach y aborde des sujets aussi complexes que
les langues orientales, le structuralisme, la question du Proche-Orient.
À ce propos, il dit : «Au Proche-Orient, les chrétiens
étaient connus pour leur charité tandis que les juifs
l’étaient pour leur espérance et les musulmans
pour leur foi très visible tous les jours dans la prière.»
Et il ajoute : «L’esprit de l’islam a imprégné
les autres religions.» (p. 33)
Le Père Kolvenbach a passé vingt ans au Liban : cela
a beaucoup marqué son existence. Il rappelle que «les
chrétiens d’Orient sont des descendants des Églises
d’origine…» et qu’elles «ont
perpétué une autre liturgie, une vie plus monastique,
et aussi une théologie qui est beaucoup plus la théologie
des Pères de l’Église que la scolastique classique.»
(p. 39)
À propos de l’Asie et de l’Afrique, le Père
Kolvenbach rappelle, d’entrée de jeu, que «La
Compagnie de Jésus a une spiritualité incarnée.
Elle poursuit la mission du Christ dans le monde d’aujourd’hui,
et c’est pour cela que nous assumons la réalité
telle qu’elle est, comme elle existe. Notre vision est donc
toujours particularisée. Ce n’est pas une vision abstraite
du monde.» (p. 51) Voilà qui résume bien
ce qu’étaient, et ce que sont encore, les maîtres
qui nous ont formés. Nous reconnaissons bien les jésuites
dans cette affirmation du général de la Compagnie
: «Et comme nous vivons dans un temps de grand relativisme,
quelqu’un qui est convaincu peut être considéré
facilement comme intolérant.» (p. 69) Rappel de
la clarté et de la solidité qui nous ont marqués
et formés ! Il y aurait encore beaucoup à ajouter
mais je vous laisse le plaisir de le découvrir vous-mêmes.
À tous ceux et celles qui s’étonnent de nous
voir aussi «engagés», le Père Kolvenbach
rappelle : «Nous voulons vraiment préparer nos
élèves à l’excellence, mais de telle
sorte qu’ils soient convaincus que c’est un don qu’ils
ont reçu pour les autres et pas exclusivement pour eux-mêmes.»
Je croyais entendre le Père Brouillé, le Père
Cambron et le plus «jésuite» de tous, peut-être,
monsieur Gérard !
Émile Robichaud, président
________________________
1 Faubourg du Saint-Esprit, Peter
Hans Kolvenbach, s.j., entretien avec Jean-Luc Pouthier, Bayard,
2004
Remonter
Jacques Lefebvre , C. 57
Jacques nous a quittés trop tôt ! Ceux qu’on
aime nous quittent toujours trop tôt.
Lors de la fête annuelle de 2002, Jacques avait reçu
une plaque commémorative en reconnaissance de son dévouement
envers l’association des anciens. À cette occasion,
Guy Pinard, C. 57 lui rendait un superbe hommage dans le bulletin
d’avril 2002 , y relatant tous les bons coups de Jacques durant
les années du collège et son implication au sein de
l’Association. Guy y soulignait cette implication engagée,
sans retenue et toujours généreuse !
Eh! Bien ! Voilà le mot clef qui décrit notre collègue
et ami : généreux ! Une générosité
sans pareil…de son temps, de ses compétences et parfois
même de ses sous. Jacques a su aider tout le monde par sa
contribution à l’Association des Anciens, à
l’organisation de nos réunions régulières
de notre conventum et toujours avec cette compétence supérieure
qui lui a valu son succès en affaires.
Voici ce qu’on peut lire sur Jacques dans le journal des finissants
de 1959: « Vous parler de Jacques est inutile, il n’est
personne à qui il ne se soit présenté. Président
de classe depuis les Éléments Latins jusqu’à
la Versification, il s’est enrôlé officiellement
dès les Belles Lettres dans le Groupe des Arpégistes
; c’est que, avoue-t-il souvent, les arts assurent une meilleur
publicité que la politique…Conciliateur dans les disputes
idéologiques qu’il suscite, dépisteur de problèmes
et chercheur insatisfait de solutions, ses anciens problèmes
d’orientation auraient été l’industrie
du miroir ou de la publicité. ( N.B. il se serait certes
épanoui dans l’une ou l’autre de ces carrières)
».
La carrière de Jacques Lefebvre a suivi cet engagement que
lui avait donné cette prédiction si juste et si descriptive.
Nous pouvons nous remémorer notre ami avec ce grand mot qu’est
la Générosité ! Il n’y a pas de plus
grande qualité qui décrira pour toujours notre ami
Jacques Lefebvre !
Richard d’Auteuil C 57
Remonter
Le grec mis au rancart…et après
?
Si d’aventure le président d’une de nos réunions
de conventum ouvrait ainsi les agapes:
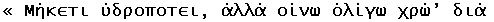
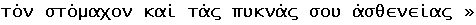
« Cesse de ne boire que de l’eau, mais prends un peu
de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes
indispositions », 1 Timothée 6,23), voire s’il
se lançait dans quelque libation à la gloire de Dionysos
dans la langue d’Homère, il y a fort à parier
qu’il s’agirait d’une réunion des plus
anciens d’entre nous, car les plus jeunes parmi les diplômés
du Sainte-Marie ne furent pas initiés au grec ancien et les
symposiarques de leurs conventums n’ont d’autre choix
que de s’en tenir au latin ou au français.
Pourtant, dix années encore avant la fermeture du collège,
l’apprentissage du grec et du latin était obligatoire
jusqu’en Rhétorique. Même si cet apprentissage
était occasionnellement remis en question à Sainte-Marie
comme ailleurs, ce n’est qu’en 1960 que la direction
du collège cédera à la pression. Le grec y
sera alors enseigné non plus à partir de la Syntaxe
mais à partir de la Méthode et il devient matière
optionnelle destinée aux « plus doués ».
Deux tiers des élèves se prévalent dès
lors de la possibilité de remplacer l’apprentissage
du grec par des cours additionnels de science.
Déjà, l’intégration des élèves
en provenance du cours classique de la commission scolaire (qui
incluait l’enseignement du latin mais pas du grec) avait amené
le collège à rendre le grec optionnel à partir
de Belles-Lettres, avec la possibilité de le replacer par
un cours de civilisation grecque.
À partir de 1965, l’introduction d’une classe
de Belles-Lettres sans grec ni latin contribue à réduire
l’importance relative de l’enseignement gréco-latin
et la création d’un département de lettres classiques
en 1967 en fait une simple spécialisation. Le nouveau département
sera intégré à l’UQAM en septembre 1969
et on y donnera des cours de grec et de latin jusqu’en 1971,
année où l’Université de Montréal
obtient le droit exclusif d’enseigner ces langues.
À l’instar du Sainte-Marie, les collèges de
l’époque abandonnent un à un l’enseignement
du grec tandis que l’enseignement du latin, malgré
un net déclin, continuera jusqu’à nos jours
d’être enseigné dans certaines institutions.
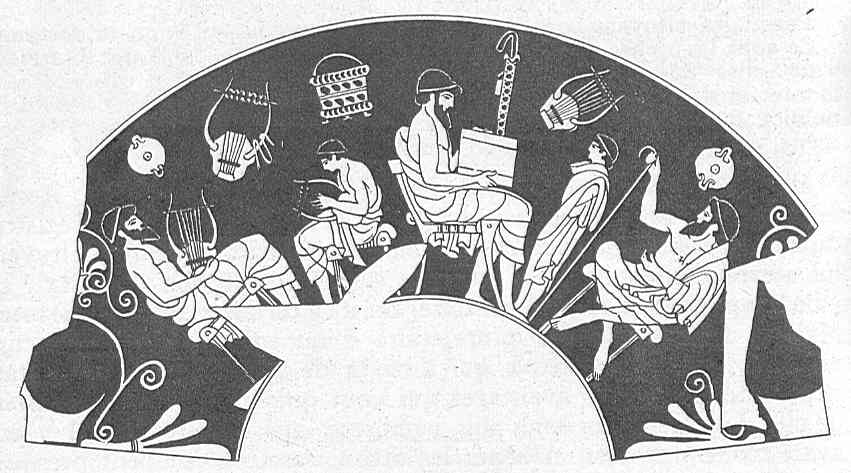
Capacité d’analyse et de synthèse, aptitude
à la lecture critique, à la dialectique, autant de
forces que contribue à développer à développer
l’enseignement du grec. Que dire d’une connaissance
plus approfondie de notre langue dont les racines plongent dans
le quotidien de la Grèce antique. Pensons non seulement aux
innombrables termes techniques et scientifiques mais aussi à
des mots d’usage courant, tels : asphalte, nausée,
magnétoscope, bible, homonyme, biographie, orthographe, monogamie,
philanthrope, cacophonie, allophone, géographie, athlète,
gymnastique, lycée, politique, érotique, gastrique,
stomacal, photographie, polémique, stratégie, etc..
autant de termes qui nous viennent en droite ligne des Grecs.
L’apprentissage de langues modernes comme l’espagnol
est un piètre substitut à celui de langues à
déclinaison, comme le grec et le latin pour le développement
de l’esprit d’analyse et surtout, cet enseignement a
peu d’impact sur le développement des capacités
linguistiques de la plupart des élèves.
L’enseignement moderne reconnaît toujours l’importance
des grands textes de l’antiquité grecque qui sont à
l’origine de la philosophie et de la science, comme de nos
valeurs morales et spirituelles, mais ces textes ne sont aujourd’hui
accessibles qu’à travers les versions traduites (combien
d’entre nous avons retenu que tous les textes du Nouveau Testament
ont été rédigés en grec ?)
L’abandon de l’enseignement du grec comme du latin a
certes contribué, avec le rôle croissant de l’audio-visuel
, à l’appauvrissement du discours politique chez nombre
de nos tribuns, plus occupés de bien paraître et d’éviter
les faux pas qu’à livrer un discours clair qui soit
le reflet d’une pensée cohérente. L’éloquence
n’est plus une qualité recherchée et la capacité
de s’exprimer avec conviction semble de plus en plus perçue
comme un défaut par notre époque qui privilégie
les phrases courtes et très simples, les euphémismes
trompeurs.
L’enseignement du grec sera-t-il un jour remis au programme
? En tous les cas, c’est ce que croit la grande helléniste
Jacqueline de Romilly comme d’autres intellectuels en grande
majorité européens qui militent pour un retour à
l’enseignement des langues classiques. De ce côté-ci
de l’Atlantique, l’enseignement du grec est toujours
donné dans quelques établissements secondaires américains
et des groupes plaident en faveur de l’enseignement des lettres
classiques. Au Québec même, où des familles
américaines et sud-américaines envoyaient autrefois
leurs enfants recevoir une formation classique, l’enseignement
du grec demeure confiné à quelques départements
universitaires. Pour combien de temps encore?

Richard L’Heureux, C. 62
Source : les informations sur l’enseignement du grec à
Sainte-Marie sont tirées du livre de Jean Cinq-Mars, Histoire
du collège Sainte-Marie de Montréal 1848-1969 ,
HMH 1998.
Remonter
Quelques
secrets de l’éloquence jésuite
Félix Martin, le fondateur du Sainte-Marie, avait un frère
aîné, Arthur, qui le précéda dans l’ordre
de Saint-Ignace et lui servit de mentor pendant de nombreuses années.
Les lettres d’Arthur à Félix renferment de sages
conseils qui gardent leur pertinence même après bientôt
deux siècles. En témoignent ces directives sur la
prédication tirées d’une lettre écrite
en 1832 :
« Quant à la manière de travailler, pour
aller plus vite, ne laissez pas un sujet vous donner de l’ennui
; passez à un autre plus neuf, pour saisir dans leur fraîcheur
les première idées qu’elle offrira. Puis vous
reviendrez au précédent… insensiblement vous
aurez un ensemble développé. C’est de la sorte
qu’on travaille la sculpture. Quand vos doigts vous démangent
et que vous avez envie d’écrire, écrivez des
traits, des pages détachées, plutôt que de
longs discours. Toutes ces pièces de rapport trouveront
leur place par la suite. Pour faire de l’effet, l’unité
de but est toute puissante. Un sermon me semble une lutte avec
l’auditoire. Je cherche à l’enlacer dans mes
bras, tantôt pour l’abattre quand il résiste,
tantôt pour l’enlever de terre, m’y prenant
de toutes les façons pour le faire s’avouer vaincu
; n’en pouvant plus quelquefois il se rend. Quand on a abattu
son adversaire, ne pas oublier de lui avancer une main généreuse
; beaucoup plus de compliments que de reproches ; mais qu’ils
soient vrais, par conséquent, réservés ;
un adversaire qui se voit attirer a moins de peine à se
rendre. »
Source : Desjardins, Paul : Le Collège Sainte-Marie de
Montréal – La Fondation – Le Fondateur, Collège
Sainte-Marie, Montréal, 1940.
Remonter
En bref
François Cousineau, C. 59, pianiste, compositeur
et interprète, a donné pour titre à son dernier
disque « CLIN D’ŒIL À DES AMIS ».
Ce titre est devenu pour l’Institut National Canadien pour
les Aveugles, une invitation sympathique à son souper-concert-bénéfice
du 30 novembre prochain, à l’Hôtel Omni de Montréal,
pour lequel François Cousineau a accepté
d’être l’artiste-animateur. Parmi les Anciens
du Collège se trouvent certainement des amis qui voudront
répondre au Clin d’œil de François en venant
entendre ses plus récentes compositions et en contribuant
à une œuvre qui célèbre en 2005 ses 75
ans d’action bénévole au Québec. Pour
plus d’information, contactez le confrère Richard
Bergeron, C.59, bénévole à l’INCA,
au 450-655-8913, ou François Beauregard, du comité
organisateur, au 514-989-4822.
Maurice Mousseau, C. 67, avocat et membre de notre
conseil d’administration, consacrait ses loisirs au chant
choral puis il décida un jour de chanter seul sur scène.
Après un premier spectacle en décembre dernier, il
se produira à nouveau en solo, cette fois sur la scène
de la butte St-Jacques, au 50, rue Saint-Jacques, les samedi 5 et
12 novembre prochain. Maurice y interprètera des chansons
de Brel, Bécaud, Lama, Bennett et autres. Le prix d’entrée
est de 20$, dont 2$ seront versés à la société
Parkinson du Québec.
Au centre de créativité du Gesù,
la 13ièmeédition de l’événement
Le sacré ré-approprié invite le public
à une recherche du sacré à travers le temps
et diverses cultures, par un programme d’expositions, de spectacles,
de conférences, de résidences de création et
une table ronde. Le programme se déroule entre le 19 octobre
et le 14 décembre 2005.
Toujours au Centre du Gesù, à la salle d’Auteuil,
une série de six conférences sur Teilhard de Chardin,
entre le 11 octobre 2005 et le 23 mai 2006. Pour connaître
les dates exactes de ces conférences et pour prendre connaissance
des autres événements au Gesù, on consultera
le site du centre de créativité du Gesù :
http://www.gesu.net/spectacles.htm
La vie des conventums. Les conventums des années
45, 50, 55, 60 et 65 devraient statutairement se réunir cette
année mais aucune date de réunion ne nous avait encore
été communiquée au moment d’aller sous
presse. Le conventum 48 s’est réuni le 3 octobre. Le
conventum 59 se réunira début novembre et on obtiendra
des informations plus complètes à ce sujet auprès
de Jacques-D. Girard, au 514 485 8114.
Remonter
Les anciens publient…..
La chronique « Les anciens publient… » paraît
dans le bulletin qui suit le Salon du livre de Montréal »
et se construit à partir d’un recensement des publications
paraissant dans le programme. Nous y ajoutons d’autre parutions
quand nous en sommes informés mais nous réalisons
bien que notre liste est loin d’être exhaustive.
Francine ALLARD, C. 68, en collaboration avec Claude JASMIN, Interdit
d’ennuyer, aux éditions Triptyque. Les auteurs
y règlent le sort du monde, y discourent sur la littérature,
la vieillesse, l’amour…
Gilles ARCHAMBAULT, C. 53, De l’autre côté
du pont, chez Boréal.
André BROCHU, C. 58, Les jours à vif, aux
Éditions Trois.
Pierre Camu, C. 42, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs au temps
de la vapeur, 1850-1950, chez Hurtubise/HMH –
Dixième volume
Jean CHARLEBOIS, élève au collège de 1956 à
1960, Blanc, bleu blanc, jaune, noir, orange, rouge, vert,
chez Lanctôt.
Jacques HÉBERT, C. 41, La comtesse de Merlin, chez
VLB.
François-J. LESSARD, C. 38, Les héritiers de l'impérialisme
romain, chez Louise Courteau.
Pierre LÉTOURNEAU, C. 59, À tort et à travers,
chez Lanctôt.
Robert MELANÇON, C. 63, Le paradis des apparences,
chez Noroît.
Notons aussi la biographie de notre confrère Denys Arcand,
écrite par Réal La Rochelle sous le titre «
Denys Arcand – l’ange exterminateur ». chez Léméac.
Il s’agit d’un livre fort dense, qui reprend une série
d’émissions radiophoniques à l’antenne
de Radio-Canada. On lira avec un grand plaisir les nombreuses pages
consacrées aux neuf années passées au collège,
entre les Éléments français et la Philo II.
Celui que Jacques Brault avait surnommé le « Voltaire
de Sainte-Marie » puisait dans ses lectures, conversations
ainsi que dans dans l’enseignement de ses professeurs, une
culture qui allait l’inspirer, dira-t-il, jusque dans ses
derniers films.
Enfin, …. dans un tout autre domaine, soulignons la publication
par l’Institut canadien canadien des comptables agréés,
du Nouveau dictionnaire de la comptabilité et de la gestion
financière, dont notre confrère Louis MÉNARD,
C. 67 est l’auteur principal. Ce dictionnaire bilingue comprenant
13 000 entrées a été réalisé
avec la collaboration de l'Ordre des Experts-Comptables et de la
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de France et de
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises de Belgique
Remonter
Le carnet
Jacques Gareau, C. 48, médecin, est toujours
au service du Département de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu
de Saint-Jérôme. Il nous rappelle que « la vie
est un combat dont la palme est au cieux. »
Jean-Louis Lalonde, C. 49, neuro-chirurgien, est
toujours actif dans sa spécialité. Cofondateur, avec
un autre ancien, Fernand Charest C. 29, du service de neurochirurgie
de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal,
il a été nommé membre émérite
des médecins de l’hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal. Mais Jean-Louis Lalonde est surtout fier d’être
l’organiste de nos fêtes annuelles.
Léo Côté, C. 50, enseignant
à la retraite, est représentant de l’Assemblée
des aînés francophones du Canada au Congrès
des organismes nationaux des aînés. Il est aussi responsable
du dossier de l’indexation des rentes à l’Association
des retraités de l’enseignement du Québec, région
de l’Île de Montréal.
Simon Richer, C. 50, pédopsychiatre, exerce
toujours sa profession à Mont-Laurier où il est très
impliqué dans la médecine mentale communautaire. Dr
Richer a déjà exposé ses sculptures sur pierre
au centre de créativité du Gésu, il poursuit
une œuvre poétique entreprise en Belles-Lettres et chante,
accompagné au piano, des œuvres de Debussy, Fauré,
Ravel et autres compositeurs français. Toujours attiré
par de nouvelles entreprises, il souhaite se lancer bientôt
dans la fabrication de livres d’artiste.
André Provost, C. 54, dentiste à
la retraite, est aujourd’hui président de l’Association
des étudiants de l’antenne universitaire du 3ième
âge – Couronne Nord.
Louis Bernard, C. 55, a posé sa candidature
au poste de chef du Parti québécois. Pour diriger
sa campagne de financement, il a fait appel à un autre collègue
ancien du collège et ex-ministre du Gouvernement québécois,
Robert Burns, C. 55.
André Brunet, C. 55, gérontopsychiatre,
a été nommé membre honoraire du réseau
santé Richelieu-Yamaska. En novembre 2004, il a été
honoré à l’occasion du 25ième colloque
annuel de la Société de psychogériatrie du
Québec, à titre de cofondateur de la société.
René Doucet, C. 55, professeur honoraire
à l’école des hautes Études Commerciales,
exploite aujourd’hui un gîte touristique sur les bords
du lac Massawippi, à North Hatley, où il est membre
du comité d’urbanisme et président de l’association
des commerçants.
Robert Lefrançois, c. 56, neuro-chirurgien,
est chef du service de neuro-chirurgie de l’hôpital
Sacré-Cœur, l’un des plus importants de Montréal.
Jean Robert, C. 56, médecin, a réduit
ses activités en milieu hospitalier pour mieux soigner les
marginalisés pas toujours bien accueillis par le système
public (itinérants, prostituées, toxicomanes, détenus,
etc..). Il intervient au Centre SIDA Amitié des Laurentides,
à la Clinique du nouveau départ, le Centre de désintoxication
de Montréal et d’autres centres, tels le Portage.
François Leclair, C. 57, qui fut aussi
Secrétaire-Général du collège, est de
retour au pays, à Gatineau, après un séjour
de quatre années à Rome.
Jean-Marie Marineau, C. 57, médecin, dirige
et administre quinze cliniques médicales au Québec,
en plus de de faire de la formation médicale en nutrition
en France où il publie également des articles scientifiques
et donne des conférences sur la nutrition. Il consacre l’essentiel
de ses loisirs à sa collection d’œuvres d’art
contemporain.
Pierre Ricard, C. 57, dermatologue, a libéré
son poste de président de l’Association des dermatologistes
du Québec et se consacre plus entièrement à
son travail de clinicien dermatologue.
Roger Bourdages, C. 59, est président du
secteur Châteauguay-Moissons de l’Association des retraités
de l’enseignement. Il nous encourage à perpétuer
la tradition.
La Presse du 17 juillet honorait notre confrère Jacques
Montplaisir, C. 60, en le nommant personnalité de
la semaine, pour sa remarquable contribution à la recherche
sur les troubles du sommeil. Aujourd’hui professeur titulaire
de psychiatrie et sciences neurologiques à l’Université
de Montréal, directeur d’une chaire de psycho-pharmacologie
et du Réseau québécois de santé mentale,
voilà bientôt trente ans qu’il se consacre à
comprendre les troubles du sommeil. Jacques Montplaisir fait remonter
son intérêt pour les troubles du sommeil à un
livre sur le sujet tiré des rayons de la bibliothèque
du collège.
Serge Montplaisir, C.60, frère de Jacques,
se consacre depuis une trentaine d’années à
la mycologie médicale, discipline qui s’intéresse
à ces champignons microscopiques responsables de nombreuses
pathologies. Professeur du Département de microbiologie et
immunologie de l’Université de Montréal et clinicien
à l’hôpital Sainte-Justine, Serge Montplaisir
a été fut l’un des fondateurs de la Société
canadienne de mycologie médicale. Il s’est aussi beaucoup
impliqué dans la dernière campagne de financement
de l’Université de Montréal, à titre
de directeur du développement de la Faculté de médecine.
Georges Leroux, C. 61, professeur au département
de philosophie de l’UQAM, a reçu le prix d’excellence
en enseignement de l’Université du Québec, pour
ses qualités de pédagogue et pour son engagement quant
à la qualité de la formation de ses étudiants.
Détenteur d’un doctorat en études médiévales
de l’Université de Montréal, Georges Leroux
enseigne depuis 1969 à l’UQAM et y a donné une
trentaine de cours de premier cycle. Il a aussi dirigé des
séminaires aux cycles supérieurs, notamment en herméneutique
et en histoire de la pensée grecque. Traducteur de Platon,
il a publié et dirigé la rédaction de 23 ouvrages.
Il est aussi largement connu pour ses émissions à
la radio et ses textes publiés dans le Devoir.
Robert Comeau, C. 62 , est depuis l’automne 2003,
titulaire de la chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec
de l’UQAM. Cette chaire est financée par la Fondation
du Prêt d’honneur, les centrales syndicales CSN, FTQ
et CSQ ainsi que le mouvement Desjardins.
Jacques Tremblay, C. 62, récemment nommé
conseiller en planification à la Direction de l’environnement
de la Ville de Montréal, aura pour responsabilité
de sensibiliser et mobiliser la population montréalaise face
aux grands enjeux environnementaux qui touchent la ville.
Michel Gratton, C. 65, a été nommé
président du chapitre de Montréal de l’Association
de redressement d’entreprises, une association qui compte
34 chapitres à travers le monde.
Pierre Martel, C. 67, a été nommé
Directeur exécutif du Bureau de l’intégrité
de la fonction publique du Gouvernement du Canada. Ce nouveau bureau
enquête sur les allégations d’actes fautifs en
milieu de travail déposées par des fonctionnaires,
contribuant ainsi à la transparence et l’excellence
dans la fonction publique.
Michel Parent, C. 67, traducteur, a été
nommé Directeur du service de la traduction du Conseil Privé.
En octobre 2004, il a été élu Vice –président
aux affaires professionnelles de l’Ordre des traducteurs terminologues
et interprètes agréés du Québec.
Remonter
Passons sur l'autre rive (Marc
3,35)
Passons sur l’autre rive (Marc 4, 35)
René Garceau, s.j., ancien professeur,
ministre de l’église du Gésu et directeur du
théatre du Gésu.
Paul-Émile Tremblay, s.j., directeur de
travaux pratiques en physique au collège de 1941 à
1945.
Eugène Proulx, s.j., ancien professeur
d’instruction religieuse au collège, décédé
à Saint-Jérôme le 9 mai 2005.
Bertrand Primeau, C. 25, médecin,
décédé le 4 avril 2005.
Paul Dumas, C. 26, médecin
et professeur agrégé à la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal,
décédé le 15 août 2005.
Yvon Sirois, C. 30, comptable,
décédé en 2005.
Maurice Filion, C. 35, comptable,
décédé le 10 juin 2005.
Noël Lefèbvre, O.M.I., C.
36, décédé à Richelieu le 2
avril 2005.
Jean-Pierre Jean, C. 37, médecin, décédé
à Montréal le 15 mai 2005.
Jean Vallières, C. 38, comptable, décédé
le 14 mai 2002.
Marcel Girard, C. 39, médecin, décédé
à Montréal le 28 février 2005.
Jean-Yves Lord, C. 39, publicitaire, décédé
à Montréal le 21 avril 2005.
Jean-Paul Saint-Louis, C. 44, juge retraité
de la Cour du Québec, décédé le 24 juin
2005.
Pierre Desjardins, C. 45, décédé
le 27 juillet 2005.
Paul Millet, C. 45, ingénieur, décédé
le 9 septembre 2005.
Miguel Giroux, C. 49, prêtre curé,
décédé le 5 juillet 2005.
Jacques Fontaine, C. 49, P.M.É., décédé
le 3 août 2005.
Gilles Cloutier, C. 52, décédé
le 10 août 2005.
Jean-Paul Corbeil, C. 53, ingénieur, décédé
le 25 septembre 2005.
Roger Lachapelle, C. 57, pharmacien, décédé
le 4 août 2005.
Jacques Lefèbvre, C. 57, relationniste
et conseiller en communications, décédé en
2005. Jacques Lefèbvre a œuvré pendant plusieurs
années au sein de l’Association, jusqu’à
ce que la maladie limite considérablement ses activités.
L’association lui avait remis une plaque en hommage à
ses nombreux services lors de la fête annuelle d’avril
2002.
Jacques-Eugène Auger, C. 58, prêtre
sulpicien, décédé le 11 avril 2005.
Jean Garneau, C. 60, psychologue, décédé
le 9 septembre.
Bruno Grégoire, C. 61, décédé
le 15 août 2005.
Jean Blanchet, C. 62, avocat, décédé
à Québec le 22 septembre 2004
Remonter
|